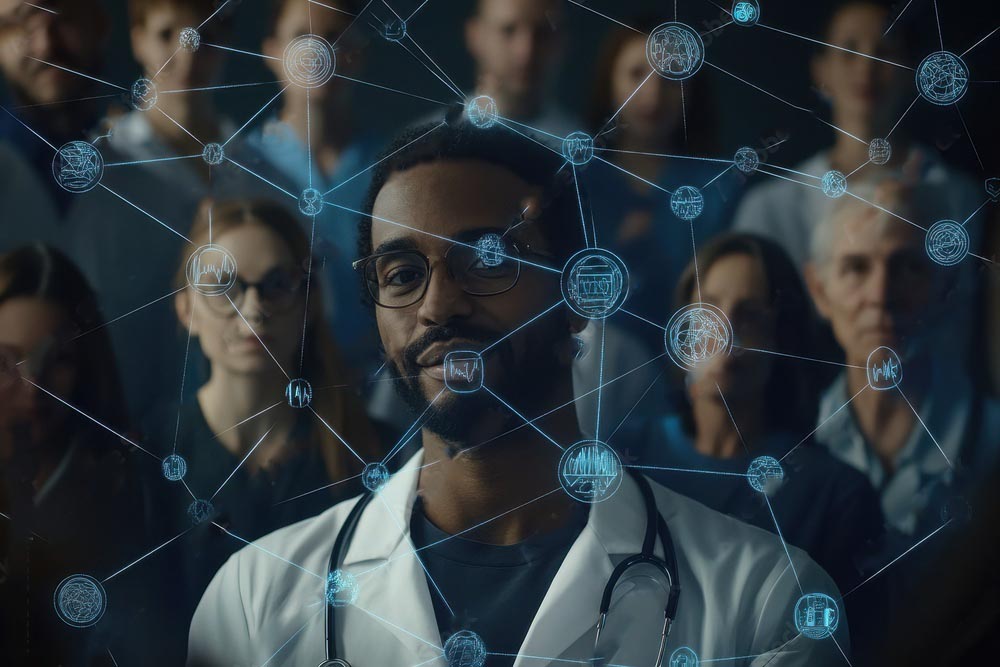L’allergie aux protéines de lait de vache, plus connue sous le sigle APLV, est une pathologie souvent évoquée chez le nourrisson… parfois un peu trop. Si l’on en croit les études, jusqu’à 15 % des bébés seraient suspectés d’en souffrir. Pourtant, les cas réellement confirmés ne dépassent guère 1 à 3 % chez les enfants nourris au biberon, et à peine 0,5 % chez les nourrissons allaités. Cette disproportion interroge, et invite à la prudence dans l’établissement du diagnostic.
Dans bien des cas, les symptômes mis en cause — coliques, régurgitations, troubles digestifs divers — relèvent davantage de la maturation encore incomplète du système digestif du tout-petit que d’une véritable allergie. « La première étape, rappelle le Dr Jean-Pierre Chouraqui, est donc de confirmer rigoureusement le diagnostic, pour éviter des évictions alimentaires inutiles. »
Des formes variées, des symptômes peu spécifiques
L’APLV peut se manifester sous deux grandes formes. La forme dite IgE-médiée apparaît dans les minutes ou les deux heures suivant l’ingestion de lait. Elle peut provoquer des réactions cutanées (urticaire, œdème), digestives (vomissements, diarrhée aiguë), respiratoires (toux, bronchospasme) ou cardiovasculaires (tachycardie, hypotension). Dans les cas extrêmes, l’anaphylaxie constitue une urgence vitale.
La forme non IgE-médiée, plus insidieuse, survient avec un décalage dans le temps, parfois plusieurs jours après ingestion. Elle se divise elle-même en deux types : la forme aiguë, qui peut évoluer vers un syndrome sévère (SEIPA), et la forme chronique, caractérisée par des symptômes diffus et persistants : eczéma, reflux, douleurs abdominales, voire un retard de croissance. Mais là encore, rien n’est jamais évident : en dehors des cas d’anaphylaxie, aucun signe n’est vraiment spécifique de l’APLV.
Une démarche diagnostique exigeante
Face à une suspicion d’allergie, différents tests peuvent être envisagés : tests cutanés (prick test), dosages d’anticorps IgE spécifiques. Toutefois, ces examens ne permettent pas à eux seuls d’affirmer une allergie. Ils révèlent seulement une sensibilisation, ce qui n’est pas synonyme d’allergie clinique.
Le diagnostic repose donc sur un enchaînement rigoureux :
- La survenue de symptômes évocateurs après ingestion de lait de vache.
- Leur disparition après 2 à 4 semaines d’éviction des protéines de lait.
- Leur réapparition lors d’un test de provocation orale (TPO), réalisé sous surveillance médicale.
Adapter l’alimentation, sans excès
Si l’enfant est allaité, on recommande à la mère d’exclure les produits laitiers de son propre régime. Dans les autres cas, on propose des formules infantiles à base d’hydrolysats poussés (où les protéines sont très fragmentées, donc moins allergisantes). Les laits à base de riz sont une alternative, tandis que les formules aux acides aminés sont réservées aux cas les plus sévères.
En revanche, les laits végétaux, de soja ou d’autres mammifères comme la chèvre, sont à proscrire. Et quel que soit le substitut choisi, la surveillance nutritionnelle est indispensable : croissance, apport en calories, protéines, calcium, vitamine D et fer doivent être suivis de près.
Vers un retour à la tolérance
Après la phase d’éviction, deux approches permettent de réintroduire progressivement le lait de vache.
La méthode dite « step-up » consiste à introduire peu à peu des aliments contenant du lait cuit (biscuits, gratins…), puis des produits laitiers plus proches du lait « cru » (yaourts, lait pasteurisé). Une stratégie qui peut réussir chez plus de 70 % des enfants, le lait chauffé étant souvent mieux toléré.
L’autre approche, dite « step-down », propose un passage intermédiaire par un hydrolysat partiel, utilisé comme pont entre l’hydrolysat poussé et le lait de vache. Cette méthode, en dehors de la phase aiguë, permet parfois d’accélérer la tolérance naturelle.
Une prise en charge sur mesure
En définitive, l’APLV est une pathologie à prendre au sérieux, mais qu’il faut savoir diagnostiquer avec mesure et méthode. Ni sous-estimée, ni surdiagnostiquée, elle doit faire l’objet d’une prise en charge individualisée, centrée sur l’enfant, ses symptômes, et son développement.
Source Le quotidien du médecin, Christine Fallet