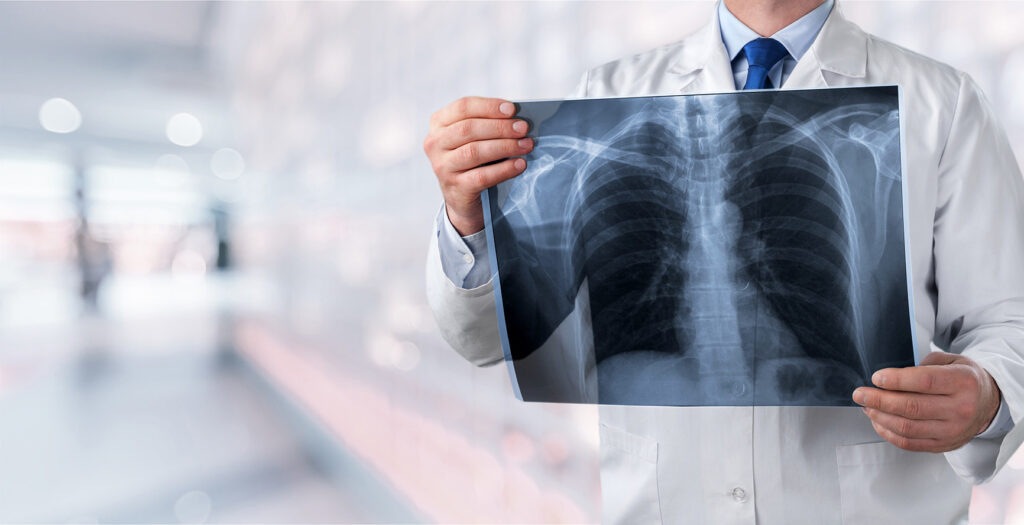Sur 237 214 médecins en activité, 118 957 sont des femmes et 118 257 des hommes, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiées fin juillet 2025. Cette féminisation de la profession, amorcée depuis plusieurs décennies, ne concerne cependant pas tous les segments de la profession de manière égale.
Le cap avait déjà été franchi depuis plusieurs années chez les praticiens hospitaliers. C’est désormais l’ensemble de la profession médicale qui est concerné : pour la première fois, le nombre de femmes médecins en exercice dépasse légèrement celui des hommes.
Cette progression féminine est particulièrement marquée chez les généralistes (52,4 % de femmes), tandis que les spécialistes restent encore majoritairement masculins (51,5 %). Mais les écarts se réduisent d’année en année.
La dynamique est également générationnelle : les femmes sont largement majoritaires parmi les jeunes médecins. Ainsi, dans la tranche des moins de 40 ans, elles représentent 62 % des effectifs. À l’inverse, les hommes sont encore nettement plus nombreux chez les plus de 60 ans. Cette répartition illustre un changement structurel profond et durable dans la démographie médicale.
Malgré cette progression du nombre total de médecins (+9,9 % depuis 2012), alimentée par l’arrivée de praticiens formés à l’étranger (11 % des effectifs en 2025, contre 7 % en 2012) et par l’élargissement du numerus clausus jusqu’en 2020, l’accès aux soins reste problématique sur de nombreux territoires. Les inégalités géographiques se creusent, et de nombreux départements peinent à attirer ou à maintenir des médecins, en particulier des généralistes.
La réforme du numerus clausus, devenue numerus apertus en 2020 – confiant aux universités la fixation des capacités d’accueil en formation – vise à mieux adapter l’offre de formation aux besoins locaux. Ses effets, toutefois, ne se feront sentir qu’à moyen terme.
En toile de fond, cette féminisation croissante interroge aussi sur l’organisation du travail médical. Les femmes médecins déclarent plus souvent exercer à temps partiel, notamment en début de carrière ou lorsqu’elles ont de jeunes enfants. Une évolution qui pousse à repenser la répartition des tâches, la permanence des soins, et plus largement, les conditions d’exercice de la profession.
Sources : Le Monde (Mattea Battaglia et Camille Stromboni) et IGAS